Anas ALAILI
Portrait du poète Palestinien exilé en France Anas Alaili
Nadia Choukroune
9/8/20255 min temps de lecture


Anas Alaili, poète des frontières et des espérances
Poète des frontières et des espérances, Anas Alaili est une voix qui marche entre deux rives : la Palestine de son enfance et les villes d’Europe où il lit et enseigne. Poète, traducteur et parolier né à Qalqiliya en 1975, il compose une poésie à la fois simple et incisive, capable de dire l’intime sans l’isoler du collectif. Sa parole, parfois murmure, parfois cri, trouve des échos dans des salles de lecture, des festivals et des collaborations musicales qui prolongent ses vers au-delà du livre.
Aux racines de la poésie : Qalqiliya et Ramallah


Naître à Qalqiliya, petite ville de Cisjordanie cernée de murs et de barbelés, c’est naître au cœur des contradictions. C’est grandir dans un paysage qui impose une conscience précoce de la fragilité de l’existence et du poids de la mémoire collective. De là vient sans doute la densité et la sobriété de la poésie d’Alaili.Ses premiers pas littéraires le mènent à Bir Zeit puis à Ramallah, où il s’engage dans les milieux culturels. Il travaille dans plusieurs centres, devient rédacteur en chef de revues littéraires, participe à l’organisation de manifestations artistiques. Ce n’est pas seulement un écrivain solitaire, mais un homme de réseaux, de collectif, qui conçoit la poésie comme une conversation plus vaste. Très tôt, il s’inscrit dans des espaces de partage. Son rôle d’éditeur, de directeur artistique et de passeur de voix le met au contact d’autres auteurs palestiniens et étrangers. De cette expérience, il garde une conviction : la poésie ne peut se réduire à une introspection individuelle, elle est aussi une responsabilité partagée, un relais.
De la Palestine à l’exil : une parole nomade
L’histoire d’Anas Alaili est aussi celle d’un déplacement. Après ses années à Ramallah, il quitte la Palestine et s’installe en France, d’abord à Lyon. C’est depuis l’Europe qu’il multiplie les lectures publiques : bibliothèques, librairies, théâtres, radios. Sa poésie voyage, portée par des festivals internationaux comme celui de Lodève, et circule dans des langues multiples : anglais, espagnol, italien, hébreu. Ce voyage n’est pas un simple éloignement : il devient le fil conducteur de son œuvre. L’exil n’est pas seulement géographique, mais aussi intime et linguistique. Le poète vit dans une langue arabe nourrie de mémoire, mais ses textes se traduisent, se déplacent, s’ouvrent à d’autres sonorités. L’exil, loin de figer son écriture, la dynamise : il lui permet d’exister dans un entre-deux, entre l’ici et l’ailleurs.
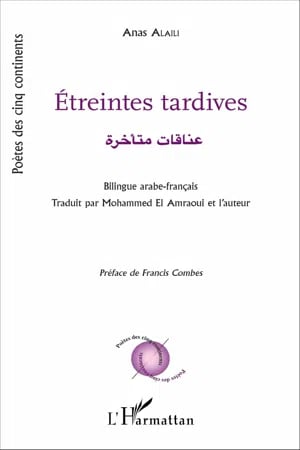
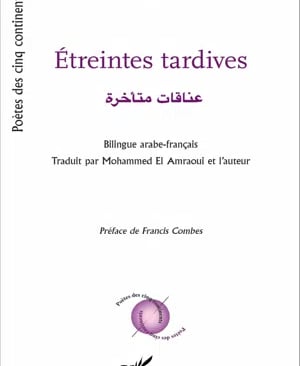
L’œuvre : du quotidien à l’Histoire
Anas Alaili publie son premier recueil en arabe en 2006 à Amman, Ma’ Fariq Basit. Trois ans plus tard, il paraît en français sous le titre Avec une petite différence aux éditions Gros Textes, avec une préface du grand poète Bernard Noël. Ce livre fondateur installe les traits caractéristiques de son écriture : une langue sobre, proche de la prose, mais qui condense en quelques images une profondeur existentielle.
Dans le poème « Des conserves éternelles », le geste banal de choisir une boîte de conserve devient une méditation sur le temps, la mort et la mémoire. « Qui décide de ce que je mange / moi ou le temps ? » demande le poète, avant d’affirmer qu’il s’engage à ne laisser mourir ni une fourmi, ni une boîte de houmous, ni même une lampe électrique. Le quotidien domestique devient l’espace où l’on lutte contre l’oubli, où l’on rend au monde sa continuité malgré la perte.
En 2016 paraît Étreintes tardives (L’Harmattan). Ici, les thèmes s’approfondissent : l’exil, les ponts brisés, les « nuées grises » qui ne sont « que fumée entassée » des incendies. Dans le poème « Étreintes tardives », le lecteur découvre un univers où les feuilles tombent « hors leurs saisons », où les visages se déforment sous le poids de l’attente, où la communication semble impossible. Mais l’écriture, justement, devient la possibilité de traverser ce vide.
Son recueil suivant, Danser d’une seule jambe, publié à Beyrouth en 2023, pousse plus loin encore cette tension entre disparition et résistance. Le pays y est décrit comme un « nuage d’été » qui se disperse, mais que le poète s’obstine à replanter de nouveaux oliviers, amandiers, caroubiers. L’image est forte : même si la Palestine disparaît des cartes et des dictionnaires, elle peut renaître par la mémoire, par la langue et par la poésie.
Ses textes les plus récents, encore inédits pour certains, abordent de front la violence des guerres contemporaines. Dans « Pour échapper au missile », il décrit avec une lucidité glaçante l’impossibilité de fuir : ni la course, ni l’hôpital, ni la mosquée, ni même le drapeau blanc ne protègent. Le poème montre une vérité nue : la mort peut frapper partout. Et pourtant, il se clôt non pas sur un désespoir total, mais sur une forme de résignation active — fumer les dernières cigarettes, attendre, écrire encore.
À côté de ce constat tragique, le poème « D’où vient l’espoir ? » cherche les petites braises de survie. L’espoir naît d’un pain retrouvé sous les décombres, d’un drapeau flottant dans le métro, d’une manifestation improbable où défilent ensemble « un transgenre et une femme voilée ». La poésie d’Alaili refuse de céder à l’obscurité totale : elle traque l’inattendu, le dérisoire, le fragment de vie qui persiste.
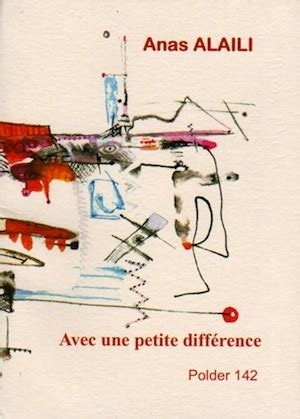
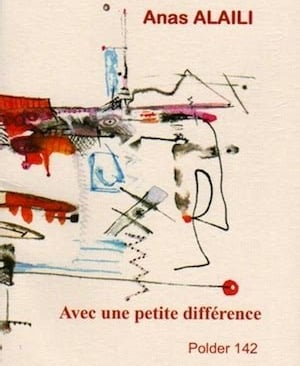
Style et esthétique : simplicité et densité
Le style d’Anas Alaili frappe par sa simplicité. Ses poèmes ressemblent parfois à des notes rapides, à des confidences écrites au détour d’une conversation. Mais cette simplicité est trompeuse : derrière elle, chaque image concentre une densité symbolique. Le quotidien n’est jamais anodin, il est traversé de mémoire et de politique.
Bernard Noël, dans sa préface à Avec une petite différence, a souligné cet humour discret qui traverse ses textes. L’humour, pour Alaili, n’est pas un luxe mais une stratégie : il permet de dire sans s’effondrer, de tenir face à l’horreur. C’est un humour doux, jamais cynique, qui fait respirer ses poèmes et leur donne une proximité avec le lecteur.
La structure de ses poèmes est souvent brève, mais rythmée par des enjambements, des ruptures qui laissent de l’air et des silences. Cette économie de moyens crée une force particulière : elle ouvre un espace d’interprétation, une respiration où le lecteur peut s’installer.
La musique comme prolongement
L’une des originalités d’Alaili est sa proximité avec la musique. Plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique par des artistes arabes, dont Yasmine Hamdan, Adel Salameh et Mohammed Najem. Cette collaboration donne une autre vie à ses textes : ils ne se contentent pas d’être lus, ils se chantent, se respirent, se dansent. La poésie d’Alaili est déjà très orale. Elle se prête naturellement à la voix, aux lectures publiques, aux performances. La musique ne fait qu’accentuer cette dimension, en lui donnant un rythme, une sonorité qui touchent au-delà de la compréhension linguistique. Même un auditeur qui ne comprend pas l’arabe peut ressentir la mélodie, la tension, la douceur des vers.

